Si les fiches que je réalise pour BDFF pèchent parfois par leur non-exhaustivité côté distribution, c'est que je n’ai pu réunir le nom de tous les acteurs, faute de preuves. En effet, la passion du cinéma qui m’anime ne m’assure pas toujours les moyens d’investigations suffisants, aussi certaines fiches pourront-elles sembler bien incomplètes aux cinéphiles qui les consulteront. Elles ont cependant le mérite de se baser sur des éléments dûment vérifiés.
Toutes les images sont cliquables pour les obtenir en plus grand.
Le dernier film de Jacques Demy vient d'obtenir le Prix Louis-Delluc
1964, que l'on se plaît à considérer comme le « Goncourt du cinéma ». Après
une série de courts métrages dont il suffit de se
remémorer les titres pour
constater à quel point
Jacques Demy sut varier
ses gammes (« Le Sabotier du val de Loire »,
« Le Bel Indifférent »,
« Ars », «le village du
saint curé»), il réalisa
« Lola », puis « La Luxure » (le meilleur sketch
des « Péchés capitaux »
de la nouvelle vague) et
« La Baie des Anges»,
aussi beau et presque aussi commercial que «Lola».
« Les Parapluies de
Cherbourg », c'était la gageure d'un poète discret
(aucune tentation d'esbrouffe, chez Demy), presque timide. Il n'y a sans
doute que les timides pour
avoir l'audace d'aller jusqu'à réaliser une idée que
d'autres se contentent de
caresser. La comédie musicale — il suffit de lire
les déclarations de presque
tous les réalisateurs qui
comptent dans le jeune cinéma français —, ils en
rêvent tous. Demy, lui, a
franchi le pas : du rêve,
il a fait une réussite.
Son oeuvre est encore plus originale que la comédie musicale classique, telle que la conçoivent les Américains, parce que, si l'on y chante tout au long, l'on n'y danse pas. Il n'y a ni danseurs ni chorégraphie pour « Les Parapluies de Cherbourg », mais le film entier semble un ballet tant les acteurs ont de grâce, d'élan, et tant Jacques Demy a su leur conserver de naturelle aisance en les faisant bouger dans une mise en scène très souple, qui épouse cependant à la perfection le rythme musical.
Car « Les Parapluies de Cherbourg », c'est un miracle d'équilibre entre la musique de Michel Legrand, résolument moderne (mais heureuse pour l'oreille la plus simple), le Jeu des comédiens et la voix des chanteurs qui les doublent. Le play-back constituait l'une des difficultés majeures de l'entreprise ; faute de perfection technique, c'eût été un désastre. C'est la perfection : on ne soupçonnerait jamais que Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo n'échangent pas de leurs propres voix leurs serments d'amour. On ne devinerait jamais que l'excellente Anne Vernon, ni aucun de ses partenaires, ne chante pas son rôle. C'est du grand art allié à beaucoup de soins. D'ailleurs, « Les Parapluies » constitue un chef-d'œuvre de raffinement sur tous les plans, dans l'emploi de la couleur, notamment, où l'on sent une immense tendresse dans la plus furtive harmonie de nuances. L'émotion esthétique, la poésie, cette tendresse, aussi, sont constantes dans ce beau film et rehaussent l'intérêt de l'histoire d'amour simplement quotidienne qui en est le sujet.
Il a fallu à Demy trois ans de lutte pour faire accepter l'idée de ce film enchanté dont il ne voulait faire ni un opéra, ni une opérette, ni une comédie musicale classique. Après huit mois de collaboration avec Michel Legrand, travaillant ensemble phrase par phrase, ils ont, imposé cette révolution par enchantement qui fera date dans l'Histoire du cinéma français. Ils susciteront probablement des imitateurs et, cela, c'est plutôt inquiétant : les miracles n'ont lieu qu'une fois.






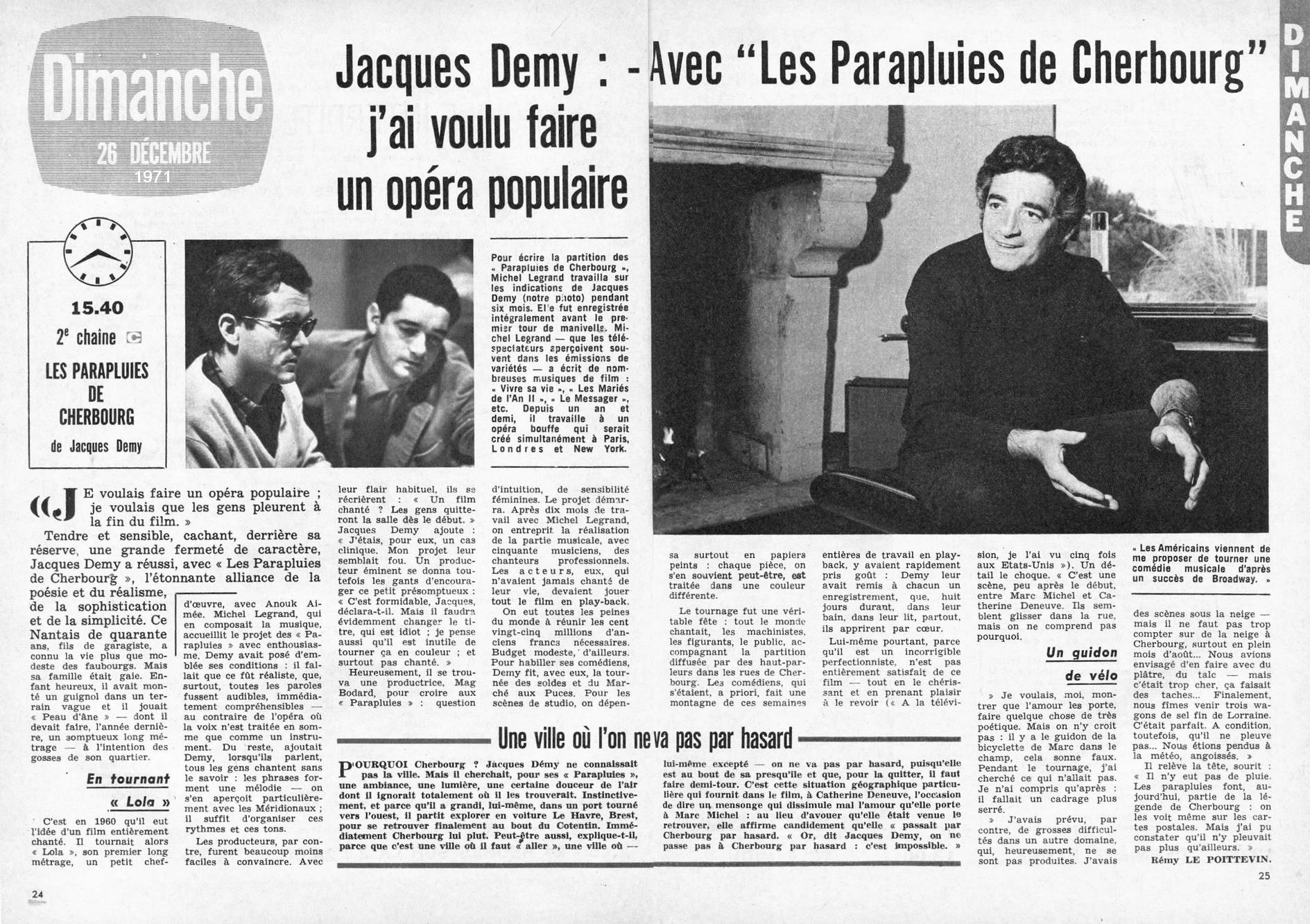


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






