Harry Baur | Naissance : 1880 Décès : 1943 | Partager cette page sur Facebook : | 1 Commentaire |
|

1916
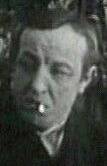
Chignon d'or
1931

Les cinq gentlemen maudits
1931

David Golder
1932

La tête d'un homme
1932

Poil de carotte
1933

Les misérables
1934

Les nuits moscovites
1935

Golgotha
1935

Crime et châtiment
1936

Les hommes nouveaux
1936

Samson
1936

Un grand amour de Beethoven
1936
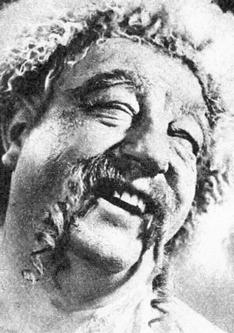
Tarass Boulba
1937

Un carnet de bal
1938

Mollenard
1938

Le patriote
1939

L'homme du Niger
1941

L'assassinat du Père Noël
1941

Volpone
1941

Péchés de jeunesse
Harry BAUR
Harry Baur est certainement l’un des plus grands comédiens qu’il nous ait été donné de voir à l’écran. Colosse fragile, acteur transformiste, il parcourt les années 30 avec la boulimie de l’ogre qui devine le sort tragique qui l’attend. Sa filmographie recèle peu de chefs-d’œuvre, d’autant qu’il ne fut dirigé ni par Feyder ou Carné ni par Renoir ou Grémillon qui redoutaient peut-être son caractère irascible ; n’importe, le plaisir reste intact de le retrouver sous la défroque d’un clochard ou d’un banquier, et plus encore lorsqu’il ressuscite sous les traits de Beethoven ou Jean Valjean.
Orphelin de père à dix ans, de tempérament ombrageux, le jeune Henri Baur ne se plie pas aux règles, fugue à treize ans vers Marseille avant d’envisager une carrière dans la marine marchande mais, inscrit à l’Ecole d’Hydrographie, il est chassé pour indiscipline. La mer restera une passion qu’il assouvira, la gloire venue, en achetant plusieurs voiliers et même un yacht. Il choisit le théâtre avec le désir d’égaler un jour son modèle, Lucien Guitry. S’il sort du Conservatoire de Marseille avec un double prix de comédie et de tragédie, il connaît des débuts difficiles sur les planches avant de trouver un emploi plus stable en qualité de secrétaire du comédien Mounet-Sully. On le remarque en 1908 dans le rôle de Moriarty, l’ennemi juré de Sherlock Holmes. Lorsqu’il crée, trois ans plus tard, « Le veilleur de nuit » de Sacha Guitry, le temps des vaches maigres est achevé. C’est aussi l’époque de ses débuts à l’écran : dès 1909, Harry Baur tourne treize films, dont « L’enlèvement de Mademoiselle Biffin » avec Mistinguett qu’il retrouve dans « La fille des chiffonniers » (1912) et « Chignon d’or » (1915) où il fait le coup de poing dans les bars mal famés. A l’occasion, il se fait cascadeur et l’on aimerait tomber sur ces bandes de l’époque héroïque où, encore svelte et athlétique, il descend en rappel du donjon de Vincennes ou plonge dans une mer démontée ! En 1923, il côtoie une légende vivante dans « La voyante » de Louis Mercanton, le dernier rôle de Sarah Bernhardt.
Pourtant, jusqu’aux débuts du parlant, c’est le théâtre qui aura les faveurs du comédien. Louis Verneuil le trouve « étourdissant de comique, de fantaisie et d’observation » lors de la création de sa pièce, « La charrette anglaise » (1916). Confronté à Raimu dans « L’école des cocottes » en 1917 ou à Elvire Popesco dans « Ma cousine de Varsovie » en 1923, il doit à Marcel Pagnol deux de ses plus grands succès : en 1926, « Jazz » est une première réussite pour le jeune dramaturge et sa vedette ; en 1931, Pagnol, fâché avec Raimu, demande à Harry Baur de reprendre le rôle de César lors de la création de « Fanny » : le comédien remporte haut la main un pari risqué mais, pour la version ciné, c’est Raimu qui rempile : « Que voulez-vous, mon cher, se justifie Pagnol, vous n’êtes qu’une vedette de théâtre et non, comme Raimu, une vedette de cinéma ! » La suite de sa carrière prouvera exactement l’inverse car, s’il trouve sur la scène du Théâtre de l’Œuvre un de ses plus beaux personnages dans « Le procès d’Oscar Wilde » en 1935, c’est bien le cinéma des années 30 qui va rendre populaire un comédien de plus de cinquante ans au physique imposant et à l’autorité manifeste. « David Golder » (1930) marque les débuts d’une belle association avec Julien Duvivier. Sa composition de père douloureux lui vaut tous les éloges. Il retrouve Duvivier au Maroc pour « Les cinq gentlemen maudits » (1931) mais l’espoir d’une nouvelle réussite passe au second plan car Rose Grane, l’épouse du comédien depuis vingt ans, meurt brutalement. Le chagrin donne sans doute encore plus d’humanité au touchant Monsieur Lepic qu’il incarne dans « Poil de Carotte » (1932), nouvelle collaboration avec Duvivier avant son apparition mémorable en commissaire Maigret dans « La tête d’un homme » (1932) – une interprétation louée par le cinéaste mais peu goûtée par Simenon !
Au premier rang des beaux souvenirs que nous lègue sa filmographie, s’impose bien sûr « Les Misérables » (1933) de Raymond Bernard, la meilleure adaptation du roman-fleuve de Victor Hugo. Harry Baur apporte au personnage de Jean Valjean toutes les nuances de son jeu, aussi crédible en bagnard taciturne qu’en notable généreux ou en père idéal. La critique américaine loua son « génie extraordinaire » dont il donna une nouvelle preuve dans « Crime et Châtiment » (1935) de Pierre Chenal : en juge Porphyre, bonhomme et faussement naïf, il tend avec soin ses filets pour prendre au piège Raskolnikov, l’étudiant assassin incarné par son ami Pierre Blanchar. Abel Gance lui propose « Un grand amour de Beethoven » (1936) : l’acteur est « ébloui » de jouer ce rôle qu’il prépare comme toujours avec le plus grand soin. Le film marque un nouveau sommet, de même que « Mollenard » (1937) de Robert Siodmak qui nous offre un affrontement de haute volée avec la grande Dorziat dans le rôle de l’épouse haineuse : « J’aimerais mieux crever ! » répond-il crûment à cette digne bigote qui lui demande de l’embrasser lors de leurs retrouvailles publiques sur les quais de Dunkerque. Devenu une vedette européenne, Harry Baur est régulièrement cité parmi les comédiens préférés du public mais vainement courtisé par les studios hollywoodiens. En 1936, année où il partage avec Gaby Morlay l’affiche de « Samson » de Maurice Tourneur, il est même l’acteur français qui cumule le plus d’entrées.
Star incontournable de l’écran, Harry Baur ne dédaigne pas cependant les participations comme le rôle de Monsieur de Tréville dans « Les trois mousquetaires » (1933), celui d’Hérode dans « Golgotha » (1935) ou l’un des ex-cavaliers de Marie Bell, devenu moine dominicain, dans « Un carnet de bal » (1937). Certains films au contexte colonialiste ont mal vieilli : on peut bondir en constatant le traitement condescendant à l’égard du continent africain dans « Les hommes nouveaux » (1936), « L’homme du Niger » (1938) ou « Sarati le Terrible » (1938). Sa prédilection pour les atmosphères russes peut aussi surprendre : en marchand de blé amoureux de la frêle Annabella dans « Les nuits moscovites » (1934), Harry Baur connaît un tel succès que les producteurs lui proposent aussitôt toute une série de personnages inspirés de Gogol ou Pouchkine. C’est ainsi qu’il paraît successivement en 1935 dans « Les yeux noirs », « Nitchevo » et « Tarass-Boulba » ; en 1938, il campe le tsar assassiné Paul 1er dans « Le patriote » et le funeste Raspoutine dans « La tragédie impériale ». Face au tonitruant comédien, des partenaires émérites comme Pierre Renoir ou Suzy Prim savent qu’ils devront baisser pavillon, à l’exception peut-être de l’aréopage prestigieux convoqué pour « Volpone » (1940) où Harry Baur paraît en majesté auprès de Louis Jouvet, Charles Dullin et Fernand Ledoux. Le plus étonnant aujourd’hui est la cruauté dont pouvaient faire preuve certains critiques à son égard, soulignant des « créations bassement commerciales » ou se disant « exaspérés par son cabotinage » !
Parvenu au sommet de sa carrière, Harry Baur ne profita guère de son aura glorieuse que la guerre allait anéantir. Remarié depuis peu à Rika Radifé, il connaît un nouveau bonheur conjugal mais de beaux projets ne verront pas le jour : il ne sera jamais Jean Jaurès sur un scénario de Carlo Rim ni Isidore Lechat dans « Les affaires sont les affaires ». A la fin de l’année 1940, une infâme campagne de presse dénonce Harry Baur comme juif et franc-maçon. Le comédien se défend en produisant un certificat d’aryanité et accepte de tourner deux films pour la Continental. Si « Péchés de jeunesse » (1941) n’est pas le meilleur Maurice Tourneur, « L’assassinat du Père Noël » (1941) est une réussite éclatante de Christian-Jaque et le dernier grand rôle du comédien, Père Cornusse attendrissant et sympathique ivrogne. Le film connaîtra un beau succès mais sa vedette n’en recueillera pas les lauriers car, au moment de la sortie, il tourne à Berlin pour la Tobis ce qui restera son dernier film, « Symphonie d’une vie » (1942). Accusé par Radio-Londres de compromission avec l’occupant, il n’en est pas moins soupçonné par la gestapo d’avoir menti sur son origine. A peine rentrés à Paris, Harry Baur et Rika Radifé sont dénoncés comme juifs et arrêtés. Alors que son épouse est transférée à la prison de la Santé, le comédien est incarcéré au Cherche-Midi. Privé de soins et de visites, il subit pendant plus de trois mois de véritables séances de torture. Finalement libéré, amaigri de plus de trente kilos, il ne se remettra pas de son incarcération et mourra six mois plus tard, quasi paralysé. Sur cette fin tragique, les explications les plus contradictoires ont couru, l’acteur étant présenté tour à tour comme collabo, résistant ou même espion de l’Intelligence Service – son fils Cecil ayant rejoint Londres dès 1940. Il semble avéré que, « devenu malgré lui une figure de la collaboration artistique franco-allemande », selon les mots de Jacques Siclier, Baur a déclenché le processus fatal en refusant à Goebbels le statut de « citoyen d’honneur du peuple allemand » qui lui était proposé. Le 12 avril, jour de son anniversaire, ses obsèques ont lieu à Saint-Philippe-du-Roule. A l’exception de Paul Azaïs – son fidèle « Zaza » - et de ses camarades Pierre Blanchar et Alcover, peu de comédiens sont présents mais le public est une dernière fois au rendez-vous.
Jean-Paul Briant












.jpg)