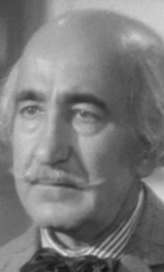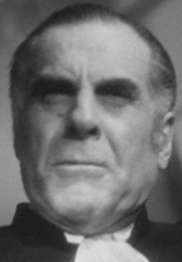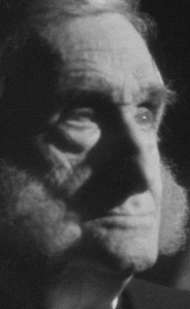Toutes les images sont cliquables pour les obtenir en plus grand.
 Gabrielle Fontan et Charles Vanel
Gabrielle Fontan et Charles Vanel
 Inconnu et Marguerite de Morlaye
Inconnu et Marguerite de Morlaye
 Inconnu jouant Leon Roquevillard
Inconnu jouant Leon Roquevillard
 Inconnue jouant Felicie bonne des Frasne
Inconnue jouant Felicie bonne des Frasne
 Inconnue jouant Germaine Marcellaz
Inconnue jouant Germaine Marcellaz
 Jacques Varennes et Mila Parely
Jacques Varennes et Mila Parely
 Jean Brochard et Jacques Varennes
Jean Brochard et Jacques Varennes
 Paulette Elambert et Charles Vanel
Paulette Elambert et Charles Vanel
 Paulette Elambert et Simone Valere
Paulette Elambert et Simone Valere
 Simone Valere et Raymond Galle
Simone Valere et Raymond Galle
 Yolande Laffon et Charles Vanel
Yolande Laffon et Charles Vanel
Charles VANEL François Roquevillard Jean PAQUI Maurice Roquevillard, fils de François Paulette ÉLAMBERT Marguerite Roquevillard, fille de François Jacques VARENNES Maître Frasne Mila PARELY Édith Frasne Aimé CLARIOND Maître Bastard Yolande LAFFON Valentine Roquevillard, épouse de François Simone VALERE Jeanne Sassenay, amie de Marguerite Fernand CHARPIN Antonio Sicardi Jean BROCHARD Philippeaux, clerc de Maître Frasne René BLANCARD Charles Marcellaz Jean PERIER Maître Hamel Raymond GALLE Raymond Bercy, fiancé de Marguerite Gabrielle FONTAN Pierrette Jacques GRETILLAT Maître Porterieux Louis SEIGNER le procureur de la République Maurice SCHUTZ Étienne Roquevillard Jeanne VENIAT Camille Roquevillard Jeanne PEREZ Madame Bercy, mère de Raymond Marcel MOULOUDJI le garçon de la pension italienne Hélène DARTIGUE Clémence, servante des Roquevillard Marguerite DE MORLAYE une vieille dame au bal Charlotte ECARD
Romancier bien oublié aujourd’hui, Henry Bordeaux publia « Les Roquevillard » en 1906, œuvre à succès déjà adaptée à l’écran par Julien Duvivier en 1922 avec Maxime Desjardins et Edmond Van Daële. Représentant en littérature du catholicisme social, l’écrivain est, au moment du tournage du film de Jean Dréville, un soutien fervent du maréchal Pétain. Toutefois, comme pour beaucoup d’adaptations littéraires tournées pendant l’Occupation, les références contemporaines sont minimes, d’autant que le scénariste Charles Exbrayat a reculé l’action aux années 1880.
La famille Roquevillard est la plus respectée de Chambéry. Le père, François, est un avocat de renom jalousé par certains de ses collègues du barreau. Maurice Roquevillard, fils de François, en stage chez Maître Frasne, tombe amoureux d’Edith Frasne. Malheureuse en ménage, la jeune femme convainc Maurice de quitter Chambéry pour toujours ; elle oublie de lui dire qu’elle emporte avec elle une somme très importante qu’elle considère comme son dû pour les six années de jeunesse qu’elle a sacrifiées à son mari. Au lendemain du départ des tourtereaux, Maître Frasne découvre la disparition de l’argent et accuse Maurice afin d’humilier la famille Roquevillard. L’affaire fait grand bruit et entraîne la déchéance familiale, Maurice étant jugé coupable par contumace. Sa mère en meurt de chagrin. Un an plus tard, Maurice apprend ce qui s’est passé et décide de rentrer à Chambéry pour se constituer prisonnier…
Le film propose une vision idéalisée d’une famille patriarcale dont tous les membres font preuve de noblesse d’âme. Charles Vanel incarne avec talent ce patriarche bienveillant, ce qui le change de l’épouvantable Isidore Lechat, son précédent rôle dans « Les affaires sont les affaires », également signé Jean Dréville. Un beau noir et blanc contrasté met en valeur les états d’âme du chef de famille qui garde sa noblesse jusqu’au bout : « Même par terre, nous serons plus grands que vous ! » lance-t-il à son ennemi plein de morgue, superbement campé par un Jacques Varennes au sourire fielleux.
Les séquences du tribunal permettent de beaux effets de manche à Jacques Grétillat et Aimé Clariond mais Louis Seigner en procureur n’apparaît, lui, que dans une seule scène. De même, on regrette que ne soit pas plus développé le rôle de Jean Brochard, très bon un clerc de notaire envieux. Gabrielle Fontan, la servante fidèle, a deux belles scènes face à Charles Vanel. La jeune garde est mieux servie du côté des femmes – Paulette Elambert et Simone Valère, toutes deux très justes – que chez les hommes, même si Jean Pâqui s’en sort bien malgré un personnage toujours un peu en retrait ; en revanche, on comprend mal que la fille Roquevillard aime jusqu’au bout son fiancé, tant Raymond Galle est mauvais acteur !
La parenthèse italienne met en valeur Mila Parély, éternelle coquette ; à ses côtés, Charpin maîtrise visiblement mieux l’accent provençal que l’accent italien : son dialogue est ponctué de fautes d’italien plutôt risibles (« fiora » au lieu de « fiore », « historia » au lieu de « storia », « escrire » au lieu de « scrivere » !) mais que ne pardonnerait-on à Charpin ?
Jean-Paul Briant, Avril 2021