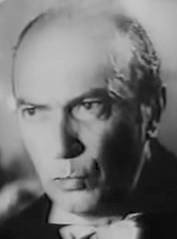Aimé Clariond | Naissance : 1894 Décès : 1960 | Partager cette page sur Facebook : | Commentaire |
|

1934

Sans famille
1935

La Route impériale
1935

Crime et châtiment
1935

Lucrèce Borgia
1937
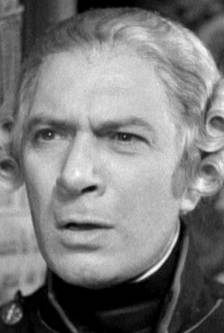
La marseillaise
1938

Les disparus de Saint-Agil
1938

Le petit chose
1938

Entente cordiale
1939

Derrière la façade
1940

Paris-New York
1941

Madame Sans-Gêne
1942
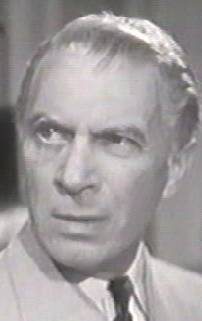
Monsieur La Souris
1942

Le destin fabuleux de Désirée Clary
1942

Le voile bleu
1942

Les affaires sont les affaires
1943

Domino
1943

La valse blanche
1943

Donne-moi tes yeux
1943

Le Baron fantôme
1943

Le chant de l'exilé
1943

Le colonel Chabert
1943

Les Roquevillard
1943

La vie de plaisir
1944

L'enfant de l'amour
1945

Le capitan
1946

Les aventures de Casanova
1947

Monsieur Vincent
1947

Le café du cadran
1948

56, rue Pigalle
1949

L'épave
1952

Foyer perdu
1953

Si Versailles m'était conté
1954

Napoléon
1955

Le secret de soeur Angèle
1955

Voici le temps des assassins
1956

Sainte Jeanne
1956

Si Paris nous était conté
1956

Marie-Antoinette reine de France
1957

Nathalie
1958

Les grandes familles
1958

Trois jours à vivre
1960

Une fille pour l'été
Aimé CLARIOND
Comédie-Française oblige, les adaptations littéraires
seront très tôt sa tasse de thé : il débute à l’écran dans « Les Frères
Karamazoff » (1931). Suivront un célèbre Feydeau, « Occupe-toi d’Amélie »
(1932), puis « Le Petit Chose » (1938), « La duchesse de Langeais » (1941) ou
« Les affaires sont les affaires » (1942). Il est un excellent Procureur de
Villefort, signant sans état d’âme l’incarcération au Château d’If d’Edmond
Dantès et finalement anéanti par la vengeance du « Comte de Monte Cristo »
(1942). Il n’hésitera jamais à se montrer antipathique au possible, plein de
morgue prétentieuse dès « Crime et Châtiment » (1934) ou « Sans famille »
(1934). Un de ses personnages les plus célèbres aujourd’hui, le bienveillant
principal du collège dans « Les disparus de Saint-Agil » (1938), cache le chef
d’une bande de faux-monnayeurs. « La vie de plaisir » (1943) en fait un
aristocrate méprisant un futur gendre roturier tout en n’hésitant pas à lui
vendre sa fille pour se renflouer. Il se rattrape dans « Le voile bleu » (1942)
en juge bienveillant, attentif aux mille et un chagrins de Gaby Morlay.