Toutes les images sont cliquables pour les obtenir en plus grand.
 Andrex Blavette et Alex Truchy
Andrex Blavette et Alex Truchy
 Blanche Destournelles et Marthe Marty
Blanche Destournelles et Marthe Marty
 Blanche Destournelles Marthe Marty et Ardisson
Blanche Destournelles Marthe Marty et Ardisson
 Elisa Ruis et Pamela Stirling au centre
Elisa Ruis et Pamela Stirling au centre
 Irene Joachim et X6 Saint Merri
Irene Joachim et X6 Saint Merri
 Jean Louis Allibert et Georges Peclet
Jean Louis Allibert et Georges Peclet
 Odette Cazau et Nadia Sibirskaia
Odette Cazau et Nadia Sibirskaia
 Pierre Renoir et Lise Delamare
Pierre Renoir et Lise Delamare
 Pierre Renoir et Marie Pierre Sordet Dantes
Pierre Renoir et Marie Pierre Sordet Dantes
 silhouettes animees par Lotte Reiniger
silhouettes animees par Lotte Reiniger
 X5 un garde national royaliste
X5 un garde national royaliste
Edmond Ardisson Jean-Joseph Bomier Andrex AndrexPaul Dullac Javel Pierre Renoir Louis XVI Lise Delamare Marie-Antoinette Jean-Louis Allibert Moissan Fernand Flament Ardisson Alex Truchy Cuculière Nadia Sibirskaïa Louison Aimé Clariond Monsieur de Saint Laurent Louis Jouvet Roederer Georges Spanelly La Chesnaye Édouard Delmont Anatole Roux "Cabri" Edmond Beauchamp le curé Fayet Jenny Hélia Louise Vauclair, l'interpellatrice Gaston Modot un volontaire à Valencienne Julien Carette un volontaire à Valencienne Georges Péclet le lieutenant Pignatel Jean Aquistapace Paul Giraud, le maire du village Maurice Escande le seigneur du village Odette Cazau Thérèse Marthe Marty la mère de Bomier Blanche Destournelles Clémence André Zibral Monsieur de Saint Merri Jean Aymé Monsieur de Fouguerolles Irène Joachim Madame de Saint Laurent Charles Blavette un Marseillais Jaque Catelain le capitaine Langlade Léon Larive Picard, le valet du roi Edmond Castel Leroux Pierre Nay Dubouchage William Aguet La Rochefoucauld-Liancourt Jacques Castelot Guémené Elisa Ruis la princesse de Lamballe Pamela Stirling une suivante Génia Vaury une suivante Lucy Kieffer une suivante Marie-Pierre Sordet-Dantès le Dauphin Louis-Charles de France Yveline Auriol Marie-Thérèse de France Werner Florian Westerman Sévérine Lerczinska une paysanne à Valencienne Géo Lastry le capitaine Massagne Géo Dorlys un chef marseillais Adolphe Autran le tambour Marseillais
Pour Jean Renoir et d'autres « compagnons de route » du parti communiste, le parallèle est évident entre les 1789 et 1936 et les événements en cours ne sont que le prolongement d'une seule et même révolution. L'avènement du Front populaire doit se traduire au cinéma par la production d'une oeuvre ambitieuse rassemblant les grands talents du pays : « Nous étions quelques-uns à penser que le moment était venu de décider le gouvernement à faire un grand film national. Le projet fut adopté à l'unanimité. Les divers éléments du scénario seront rassemblés par Charles Spaak. Les dialogues de Paris et des faubourgs seront écrits par Jeanson, Achard se chargera de faire parler les émigrés de Coblence et Pagnol écrira les textes de Robespierre. La musique sera écrite par les meilleurs compositeurs que possède la France : Arthur Honegger, Georges Auric, Darius Milhaud, Kosma. La distribution et l'ensemble de la direction des acteurs seront confiées à Louis Jouvet, notre grand Jouvet qui sera Robespierre. Pierre, mon frère sera Brissot, Gabin sera un menuisier du faubourg Saint-Antoine, Erich von Stroheim sera l'officier autrichien qui dirige les troupes à Valmy et je demanderai à d'autres gloires de venir tenir des rôles épisodiques. Maurice Chevalier sera même un ouvrier chantant la Marseillaise... ».
L'idée de financer le film par une souscription populaire est lancée par Renoir le 11 février 1937. Le 12 Mars, au cours d'un meeting animé par Paul Vaillant-Couturier il est proposé aux sympathisants d'avancer 2 francs d'à-valoir sur le prix du billet. Malgré un départ encouragent, la souscription ne donne pas les résultats attendus et une production plus classique doit prendre le relais. De plus, les difficultés du Front populaire privent le film du soutien du gouvernement. Le projet doit être redimensionné. Le premier scénario aurait donné un film de douze heures. Renoir abandonne l'idée d'une fresque embrassant l'intégralité de la Révolution française pour se concentrer sur la montée des fédérés Marseillais à Paris. La plupart des prestigieuses collaborations envisagées sont abandonnées. Jouvet reste seule tête d'affiche d'une distribution complétée par des acteurs familiers de Renoir. Les Marseillais seront interprétés par des comédiens marseillais. Le tournage démarre en août 1937 et dure quatre mois.
La première de "La Marseillaise" a lieu le 9 février 1938 à l'Olympia. L'accueil critique, quand il ne met pas en cause la personne même de son réalisateur, relève plus du parti pris idéologique que d'une analyse objective du film. Brasillach écrit : « Renoir, ce gros garçon joufflu qui lève le poing dans les meetings. », Rebatet : « un véritable artiste, le plus dangereux des partisans ». A l'autre bout du spectre politique Aragon écrit : « Jean Renoir a fait un film si actuel, si brûlant, si humain qu'on est pris, emporté, entraîné pendant plus de deux heures comme si c'était notre propre vie qui se débattait là sous nos yeux et de fait, c'est notre propre vie. ».
Les public est, quant à lui, loin d'offrir à "La Marseillaise" le succès attendu. L'optimisme des premiers temps du Front populaire a cédé le pas à la crainte de voir éclater une nouvelle guerre et le film de Renoir n'est plus tout à fait dans l'air du temps. C'est en Union soviétique que "La Marseillaise" rencontre un véritable succès populaire. Avec 250 copies, le film y est largement distribué et 12 salles moscovites le passent sans discontinuer.
Le film est censuré en France pendant l'occupation et des scènes sont perdues. Quand, en 1967, Jean Renoir rachète les droits du film pour en faire un nouveau montage, il doit recourir à des séquences sous-titrées en Russe pour combler ces lacunes.
Une des réussite de Renoir est sans doute d'avoir su tenir la ligne de conduite qu'il annonçait au moment du tournage : « Je mentirais si je disais que dans cette lutte d'idée je reste impartial. Je tourne "La Marseillaise" avec une conviction très ferme, je veux faire un film partisan mais de bonne foi. ». Le film évite en effet tout manichéisme et le réalisateur exprime avant tout l'amour qu'il porte à ses compatriotes et à l'idéal d'une nation « réunion fraternelle de tous les Français ». Claude-Jean Philippe pourra dire de "La Marseillaise" : « Jamais autant dans un film qui prend la liberté pour sujet, le spectateur ne fut si largement convié à faire usage de la sienne. ».






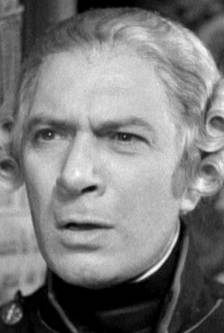





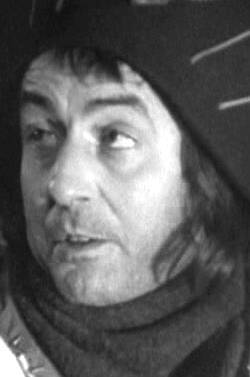


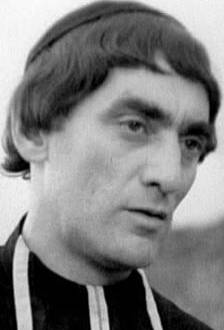




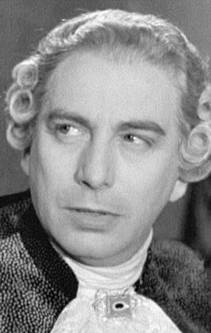
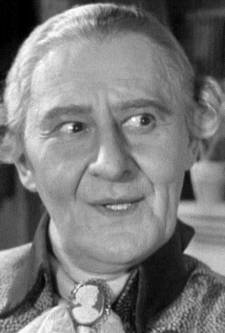






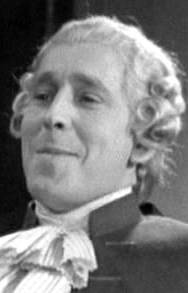







.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)














