Toutes les images sont cliquables pour les obtenir en plus grand.
 Ginette Leclerc et Liliane Maigne
Ginette Leclerc et Liliane Maigne
 Micheline Francey et Pierre Fresnay
Micheline Francey et Pierre Fresnay
 Pierre Fresnay et Ginette Leclerc
Pierre Fresnay et Ginette Leclerc
 Pierre Fresnay et Micheline Francey
Pierre Fresnay et Micheline Francey
 Pierre Larquey et Pierre Fresnay
Pierre Larquey et Pierre Fresnay
 Liliane Maigne et Ginette Leclerc
Liliane Maigne et Ginette Leclerc
Pierre Fresnay le docteur Rémy Germain Ginette Leclerc Denise Saillens Micheline Francey Laura Vorzet Pierre Larquey le docteur Michel Vorzet Héléna Manson Marie Corbin, une infirmière Noël Roquevert Saillens, le directeur de l'école Liliane Maigné Rolande Saillens Roger Blin François Sylvie la mère de François Pierre Bertin le sous-préfet Antoine Balpêtré le docteur Delorme Louis Seigner le docteur Bertrand Jean Brochard Bonnevie, l'économe de l'hôpital Bernard Lancret le substitut Delorme Gustave Gallet Fayolle Jeanne Fusier-Gir la mercière Robert Clermont M. de Maquet, le maire Pierre Palau le receveur des postes Marcel Delaître le dominicain Lucienne Bogaert la femme voilée qui provoque Germain Nicole Chollet la bonne de Vorzet Étienne Decroux un villageois Albert Malbert le Suisse Marie-Jacqueline Chantal une villageoise Pâquerette une villageoise Palmyre Levasseur une villageoise Paul Barge un villageois Eugène Yvernès un villageois Albert Brouett un villageois
SCENARIO Louis Chavance et Henri-Georges Clouzot ; IMAGES Nicolas Hayer ; DECORS André Andrejew ; MONTAGE Marguerite Beaugé ; SON William-Robert Sivel ; MUSIQUE Tony Aubin ; PRODUCTION Continental-Films
Une petite sous-préfecture de province voit sa tranquillité bouleversée par une multitude de lettres anonymes dénonçant les turpitudes réelles ou supposées de ses habitants. L’hôpital est au cœur de la tourmente. Le docteur Germain, installé récemment dans la ville, est plus particulièrement visé…
« LE CORBEAU est un indiscutable chef-d’œuvre. Ce qui ne l’a pas empêché d’être interdit à la libération pour avoir été produit par la firme allemande Continental Films. Circonstance aggravante, mais jamais vérifie, il aurait été distribué en Allemagne sous le titre « Une petite ville française », participant ainsi à une propagande insultante. En réalité, Clouzot s’en prend dans LE CORBEAU à la contagion de la délation, dont on sait qu’elle fut une triste réalité pendant l’occupation… C’est donc plutôt son réalisme psychologique qui à dérangé : on avait pas l’habitude d’une telle noirceur (…) » - Gérard Lenne, Dictionnaire mondial des films, Larousse, 1991.
« Œuvre capitale dans l‘histoire du cinéma français. L‘éblouissante perfection formelle du film (agencement du scénario, découpage, interprétation) aboutit à un récit complexe mais assez bref de 93 minutes qui décrit en profondeur , à travers une douzaine de personnages l‘atmosphère d‘une petite ville française des années 30. La peinture de Clouzot (c’est-à-dire ses images) est plus noire que sa philosophie (c’est-à-dire ses dialogues) qui met en avant la relativité des notions morales et invite ainsi à une certaine modération de jugement. Le film, indiscutablement sincère (…) provoqua un ébranlement profond dans le public et la critique à cause de la formidable rupture de ton qu’il introduisait par rapport au cinéma d’avant-guerre. La férocité de l’analyse sociale, si fréquente dans les films français des années 30, apparaît ici glaciale, absolument dénuée d’ironie. Elle est crue, directe, n’offre aucune échappatoire au public dans le rire ou la dérision. L’auteur croit viscéralement à ses monstres et oblige le spectateur à se contempler en eux comme dans un miroir (…) » - Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma ; Les films, coll. Bouquins, 1992.

















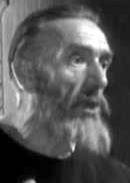









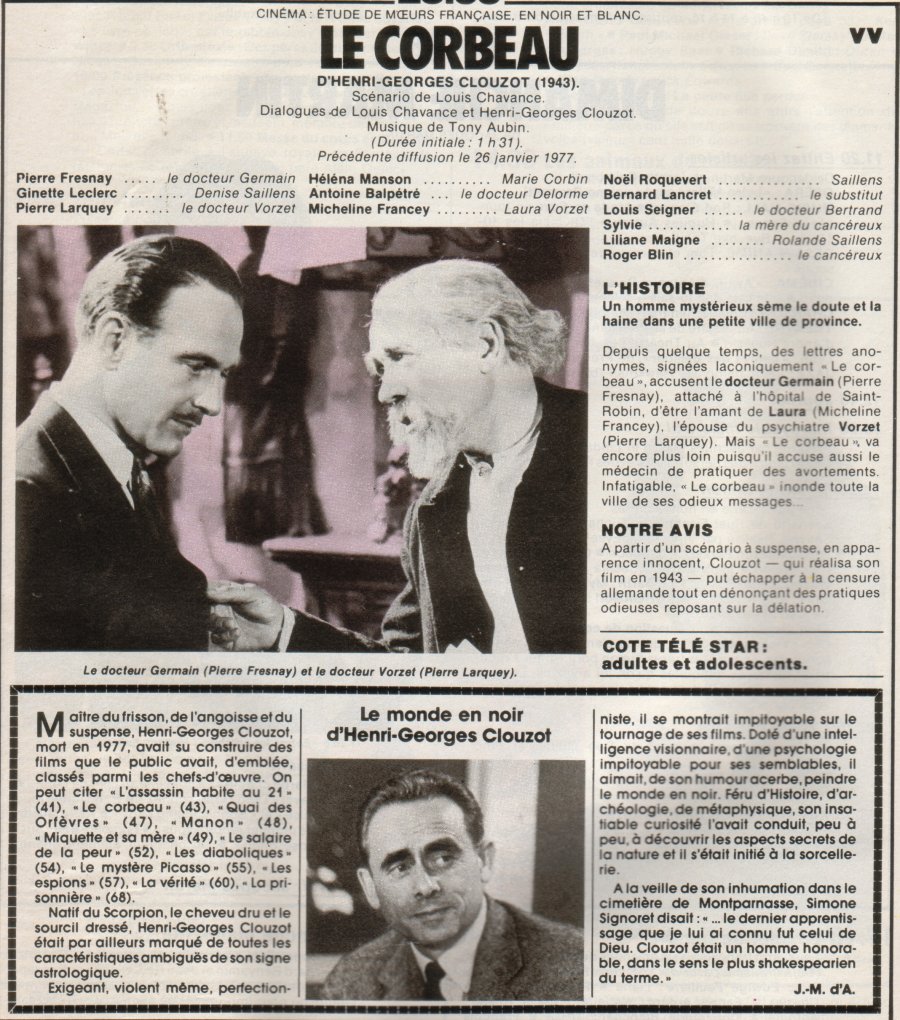
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)















