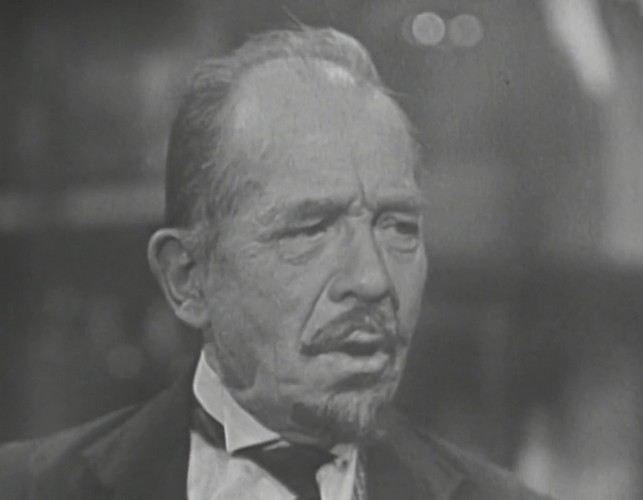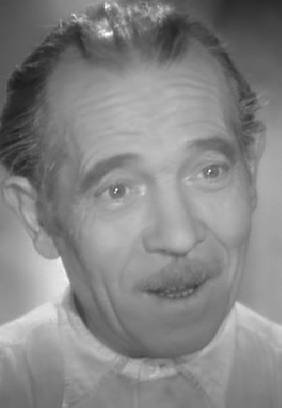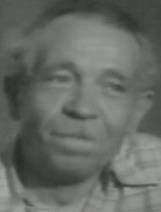Pierre Larquey | Naissance : 1884 Décès : 1962 | Partager cette page sur Facebook : | 1 Commentaire |
|

1931

Sola
1933

Topaze
1933

Les misérables
1934

Si j'étais le patron
1934

Madame Bovary
1934

Le grand jeu
1934

Zouzou
1934

L'école des contribuables
1934

Compartiment de dames seules
1934

Le Cavalier Lafleur
1934

Justin de Marseille
1935

Un oiseau rare
1936

La terre qui meurt
1936

Romarin
1936

Le roman d'un spahi
1937

Mademoiselle ma mère
1937

Rendez-vous Champs-Elysées
1937

Les filles du Rhône
1937

Ces dames aux chapeaux verts
1937

L'habit vert
1938

Les trois artilleurs en vadrouille
1938
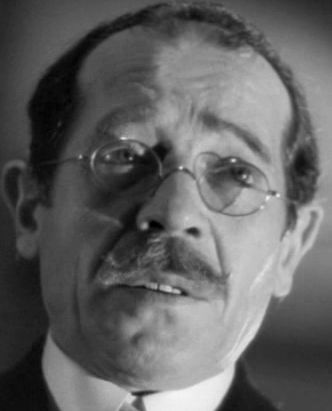
Les otages
1938

La chaleur du sein
1941

Nous les gosses
1941
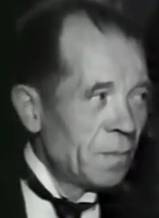
Fromont jeune et Risler aîné
1942

Le lit à colonnes
1942

Le bienfaiteur
1942
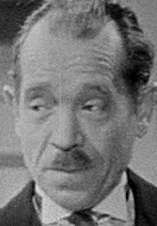
Le journal tombe à cinq heures
1942

Le voile bleu
1943

La main du diable
1943

Le corbeau
1944

Le père Goriot
1944

La collection Ménard
1945

Sérénade aux nuages
1945

Sylvie et le fantôme
1946

Jericho
1946
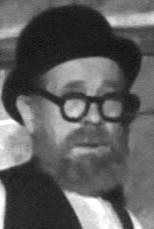
La femme en rouge
1947

Carré de valets
1947

Quai des orfèvres
1947

Six heures à perdre
1948

La femme que j'ai assassinée
1948

Le fiacre numéro 13
1949

La maternelle
1950

Topaze
1950

Les anciens de Saint-Loup
1950

Le furet
1951

Mammy
1951

Le dindon
1952

Le trou normand
1952
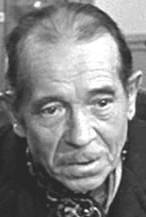
Monsieur Leguignon, lampiste
1953

Le chasseur de chez Maxim's
1953

Si Versailles m'était conté
1954

Trois jours de bringue à Paris
1954

Le Congrès des belles-mères
1954

nouveau
Faites-moi confiance
1955

Les diaboliques
1955

La Madelon
1956

Si Paris nous était conté
1956

Topaze
1956

Assassins et voleurs
1957

L’habit vert
1957

Les espions
1958

La p... sentimentale
1961

Le président
1961

Otez votre fille s'il vous plaît
1961

Par-dessus le mur
1962

Dossier 1413
Pierre LARQUEY
Le bon papa Larquey a enchanté trente ans de cinéma français de sa présence bonhomme et de sa voix chaude fleurant son Sud-ouest natal. Issu d’un milieu modeste, il n’eut aucun mal à endosser les rôles de petit paysan, de domestique ou de simple troufion que le cinéma des années 30 lui attribua volontiers. Avant cela, il fréquenta longtemps les planches, tour à tour comique troupier ou pensionnaire du Théâtre des Variétés, où Marcel Pagnol vient lui proposer le rôle de Tamise, brave compagnon de misère du professeur « Topaze ». Au cinéma, Larquey retrouvera l’intègre Tamise par deux fois, face à Jouvet en 1933 et en 1950 face à Fernandel dans la version signée Pagnol.
Dès 1931, Larquey se met en marche pour un marathon de 200 films. Bien sûr, il ne fait pas toujours le tri entre « Madame Bovary » (1934) de Jean Renoir – il y joue Hippolyte, le pied-bot - et la piteuse trilogie des « Trois Artilleurs » où il incarne le pharmacien Zéphitard « en vadrouille », « à l’opéra » ou « au pensionnat » ! 1934 est une année faste puisqu’il tourne la bagatelle de vingt films dont « Compartiment de dames seules » où il rêve en vain de divorcer de l’envahissante Alice Tissot, un « chameau » qu’il appelle pourtant Herminette. A cette époque, il paraît, le clairon au bec, dans « Le grand jeu » (1933), en tambour de ville dans le premier « Knock » (1933) ou en truand irrésistiblement bègue dans « Justin de Marseille » (1934). Il aime porter la livrée comme dans « Un oiseau rare » (1935) où son richissime patron l’oblige à un échange de rôles qui lui déplaît fort. Au début de « L’habit vert » (1937), on le voit enseigner à son fils – un Bernard Blier bien empoté- les us et coutumes de l’Académie Française. Toute une époque fleurit à travers le nom de ses personnages : adjudant Gonfaron ou Colleret, père Mélé ou père Ballot, Ulysse Hyacinthe ou M. Lacroustille, M. Bouton, M. Moineau ou « Clodoche » (1938). S’il s’appelle Lajoie dans « L’amant de Bornéo » (1942), c’est visiblement par contraste avec la triste figure qu’il arbore en étudiant les comptes d’un patron dispendieux joué par l’ami Tissier. Sa petite moustache et sa calvitie naissante sont célèbres, même lorsqu’il rase la première et cache la seconde sous une perruque 18e dans « Adrienne Lecouvreur » (1938). Quelques films lui réservent le premier rôle comme « Un soir de bombe » (1935), une plaisanterie de Maurice Cammage, où il joue le double rôle d’un banquier et d’un clochard ; plus sérieusement, son visage de vieux paysan vendéen, cheveux blancs et pipe au bec, orne l’affiche de « La terre qui meurt » (1936), le premier film français en couleurs ; Bernard-Deschamps en fait un père célibataire dans « La marmaille » (1935) et, dans « Monsieur Coccinelle » (1938), un petit fonctionnaire rêveur encombré d’une épouse rabat-joie. « Grand-père » idéal dans un petit film de 1938, il brille dans « Les otages » (1939) de Raymond Bernard, au milieu d’une belle brochette de notables campés par ses valeureux collègues, Charpin, Saturnin Fabre et Noël Roquevert.
Les années 40 vont l’imposer comme une figure majeure du cinéma français. Certes, ce n’est pas grâce à « Pension Jonas » (1941) même s’il y est toujours aussi sympathique en Barnabé Tignol, clochard installé dans une baleine empaillée au Muséum d’Histoire Naturelle. C’est en premier lieu Clouzot qui démontre que l’aimable Larquey cache des abîmes de noirceur dans « L’assassin habite au 21 » (1941) où son association avec Tissier et Roquevert couvre les crimes de l’énigmatique Durand. « Le Corbeau » (1943) lui permet d’atteindre les sommets. Psychiatre morphinomane, le docteur Vorzet inonde la ville de lettres anonymes et s'interroge sur la frontière entre le bien et le mal : « Où est l’ombre ? Où est la lumière ? » demande-t-il à Pierre Fresnay dans le passage le plus célèbre du film. Dans « La collection Ménard », tourné la même année, il est de nouveau psychiatre mais en version délirante puisqu’il propose à ses patients de… brouter ! Professeur Star dans « Le Furet » (1949), il joue de son ambiguïté car le sympathique voyant à la boule de cristal dissimule un malfaiteur. « Le Père Goriot » (1944) aurait dû lui apporter la consécration suprême : si cette adaptation littéraire manque de souffle, Larquey réussit admirablement la scène de son agonie misérable. En 1949, il interprète à la radio Monsieur Jourdain et des comédiennes aussi prestigieuses que Françoise Rosay et Madeleine Renaud ne résistent pas au plaisir de servir Molière en sa compagnie.
Malgré ces personnages de premier plan, Larquey reste un grand second rôle qui excelle dans les compositions en apparence mineures, comme celle de l’aimable Dix Doigts, gardien de prison dans « Le lit à colonnes » (1941), le propriétaire bienveillant de « L’ange de la nuit » (1942) ou le domestique d'Odette Joyeux dans « Le mariage de Chiffon » (1942). Trois ans plus tard, il jouera son père attendrissant dans « Sylvie et le fantôme » (1945) où l’on aime le retrouver en châtelain ruiné, fumant la pipe dans son lit à baldaquin. Dans « La Main du diable » (1942), son apparition suffisait à faire sourdre la peur panique née de la « Main Enchantée » imaginée par Gérard de Nerval. Mendiant unijambiste surnommé Béquille, il est très émouvant en otage sur le point d’être fusillé dans « Jéricho » (1945). Amoureux de Gaby Morlay dans « Le voile bleu » (1942) – il l’épousera dans « Mammy » (1950) - il succombe au charme d’un ange joué par Simone Renant dans « La tentation de Barbizon » (1945) d’autant qu’elle le transforme pour deux heures en séducteur, un emploi plutôt inhabituel pour lui (« Avec ma gueule ? » s’exclame-t-il !). André Luguet occupe d’ailleurs ses « Six heures à perdre » (1946) à redonner à la volage Paulette Dubost l’envie d’aimer à nouveau ce mari bienveillant.
Chauffeur de taxi malmené par la police (« On n'est pas les plus forts ! ») dans « Quai des Orfèvres » (1947), il retrouve, toujours chez Clouzot, le même emploi dans « Les espions » (1957). Dans « Les diaboliques » (1954), enseignant médiocre d’une sinistre pension, il se fait traiter de « vieux chameau » par Simone Signoret. En guise de compensation, il fut tout de même directeur d’école dans « Les anciens de Saint-Loup » (1950). C’est l’époque où Sacha Guitry recrute son ancien partenaire au théâtre comme guide touristique pour « Si Versailles m’était conté » (1953) avant de l’embastiller dans « Si Paris nous était conté (1955). Avec « Assassins et voleurs » (1957) et « Les sorcières de Salem » (1956), ce sont hélas les rares titres glorieux de ces années 50, surtout marquées par quelques sympathiques nanars comme « Le trou normand » (1952) sans parler de la tambouille bordelaise de la maison Couzinet (cinq films au compteur !) et l’on souffre pour lui de le voir en caleçon subir les invectives d'une Jeanne Fusier-Gir déchaînée dans « Le congrès des belles-mères » (1954). Dans « La famille Cucuroux » (1953), il débite, imperturbable, des répliques ahurissantes comme : « Que monsieur veut-il que je lui fesse… euh, fasse ? »
L’âge venant, il semble délaisser le cinéma et consacre sa semi-retraite à l’entretien de sa propriété de Maisons-Laffitte. Avant de tirer sa révérence, il parut, plus vrai que nature en vieux paysan sur son tracteur, conversant amicalement avec Jean Gabin, « Le Président » (1960). A la télévision, on le revit - Tamise tout de même très fatigué - dans une nouvelle version de « Topaze » (1956) ou reprenant son rôle de secrétaire de l’Académie Française dans « L’habit vert » (1957). Contrairement au Père Jules, le malicieux doyen des français - son personnage dans « Millionnaires d'un jour » (1949) – Larquey ne vécut pas centenaire mais mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 77 ans : il y trouva enfin le repos auquel aspirait l’allumeur de réverbères sur un enregistrement fameux du « Petit Prince » où sa gouaille sympathique berça des générations d’enfants.
Jean-Paul Briant